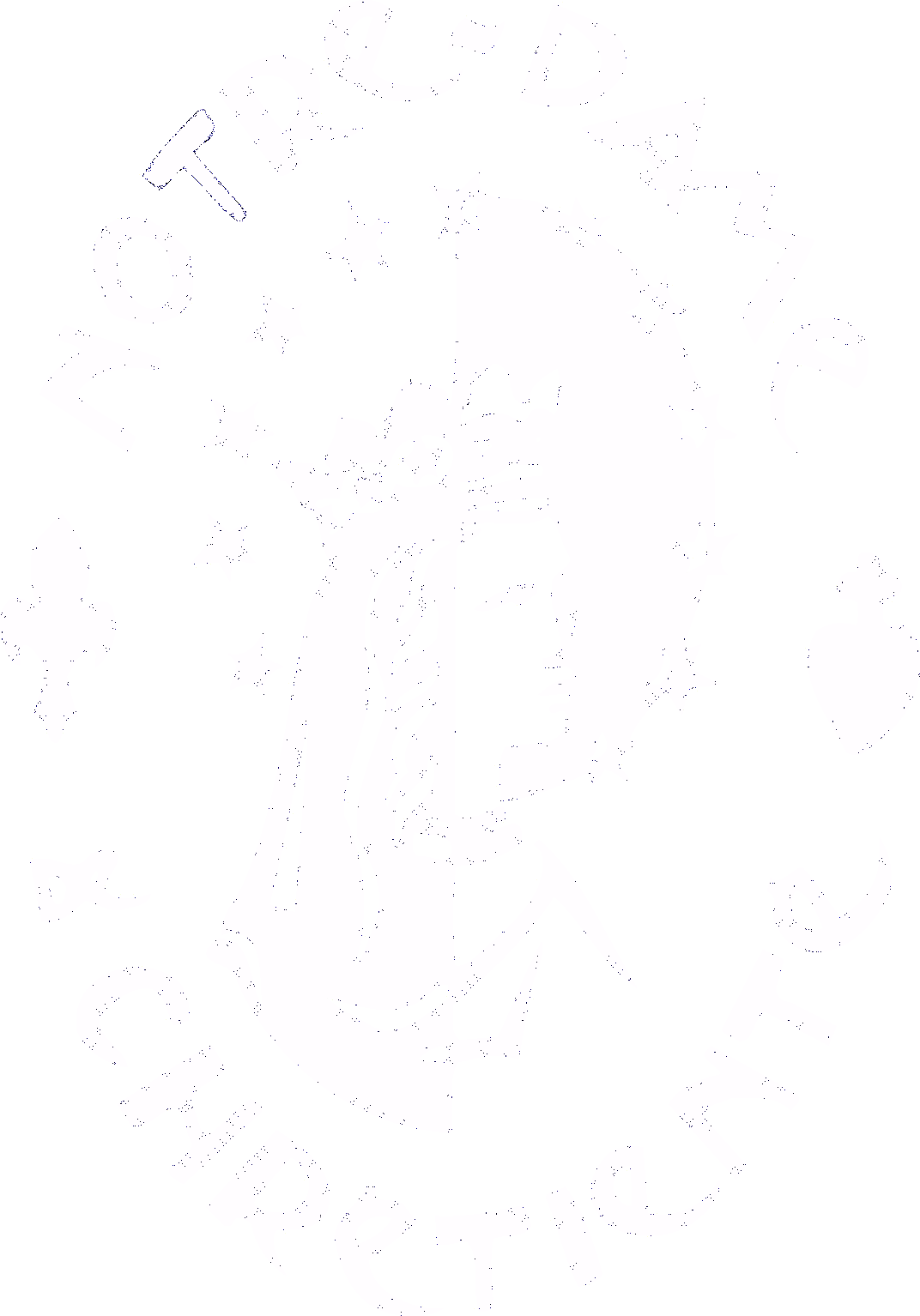> accueil > Le pčlerinage 2007 > Consécration
Consécration ā Marie
Consécration mariale, méditons encore
Témoignage dun consacré,
ancien président de Notre-Dame de Chrétienté
(actuellement secrétaire du comité de parrainage)
Le mouvement dappel ā la consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie prend de lampleur.
Cest bien. Cest męme trčs bien car il répond ā une nécessité dordre stratégique pour le développement du pčlerinage et lédification de la chrétienté.
Ces considérations mont conduit ā ętre associé ā un travail de réflexion autour du développement de cette dévotion pour le bien de chacun et celui du pčlerinage.
Il s'agissait, en effet, darticuler la démarche individuelle de la consécration avec sa dimension communautaire et den solenniser la cérémonie.
On ma ainsi demandé dapporter mon témoignage et je le fais volontiers ici car, pour l'avoir vécu moi-męme, la consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie, en engageant tout l'ętre, est un acte autant individuel que communautaire.
C'est au cours d'une retraite ā Paray-le-Monial que, dans le secret de ma cellule, j'ai prononcé cette pričre avec la pleine conscience de faire un acte important bien que sans témoin. Pour aller jusqu'au bout de mon adhésion, j'ai męme signé le texte de cet acte de consécration, petit formulaire distribué habituellement par le Pčre Roustand aux retraitants. Jen ai gardé la trace. C'était le 22 août 1969.
Plus tard, c'était le 14 avril 1993, un mercredi soir, aprčs la messe mensuelle de préparation du pčlerinage, j'ai renouvelé ma consécration, seul au pied de l'autel, en présence de M. l'abbé Pozzetto, devant toute l'assemblée des fidčles. A l'issue de la lecture du texte, je suis allé déposer une rose sur l'autel. Nous en avions beaucoup parlé avec M. l'abbé; il nous paraissait nécessaire d'entourer cet acte d'une certaine solennité.
Avec le recul, on constate que cette appartenance, cet Ŧ esclavage ŧ, se traduit de faįon mystérieuse mais bien concrčte sur le cours de sa vie personnelle, famille, professionnelle (un certain 22 août 1989 pour moi par exemple) et "militante". Le ciel prend au sérieux nos engagements.
Par la suite, je me suis retrouvé aux postes de responsabilités que vous savez. Ce n'est pas au hasard que je donnais le signal du départ au pčlerinage ; je vérifiais, voir jattendais, quitte ā prendre du retard, que la statue de la Sainte Vierge ait rejoint la tęte de la colonne avant de donner le feu vert. Il y avait de ma part tout un acte d'allégeance et de supplication : " A vous de jouer, Notre Reine".
C'était ma maničre de répondre, en termes de stratégie, aux observations que je faisais de ce phénomčne Ŧ pčlerinage ŧ et j'étais bien placé pour l'ausculter. Quelle "main cachée" dirige ce pčlerinage ? A quelle vocation répond-il ? Quels en sont les enjeux alors que j'entends comme un air d'avant le ralliement de Léon XIII et męme d'avant 1793 ? Que se passe-t-il ? On croit ręver ; c'est inédit et totalement improbable. De plus, c'est beau et cela a une allure folle. C'est ma famille. Enfin !
On retrouve dans cet itinéraire personnel l'ensemble des questions que nous avons ā résoudre aujourd'hui : l'appel intérieur, les hésitations et les obscurités, la présence du prętre, la cérémonie et le signe sensible (un texte, une signature, une rose, un cierge, un pas, une procession, etc.), l'acte individuel et sa composante publique en raison de son inscription dans la logique du pčlerinage. Ce dernier paramčtre n'est pas secondaire ; il conditionne l'équilibre général de l'action collective que nous allons engager. A ce titre, nous pouvons garder en mémoire ces deux consécrations collectives, lune il y a deux ans avec cinq des principaux dirigeants de Notre-Dame de Chrétienté (H. de Gestas, B. de Beaurepaire, O. de Durat, M. Joulie et moi-męme), lautre le 29 septembre dernier avec la nouvelle équipe le noyau du chapitre Saint Joseph - autour dOlivier de Durat. Ce fut loccasion de lire des actes de consécration ā la fois individuels et collectifs.
Nous avons dit "stratégique". Le pčlerinage n'est pas une option ad libitum. C'est une "ardente obligation".
Certes, la Providence, dans sa gratuité, peut se passer de ce phénomčne marginal. Quest-ce quun petit pčlerinage ? Mais nous, responsables du pčlerinage, nous navons pas le droit de Ŧ planter le pélé ŧ. Et si vous saviez comme ce serait facile !
Pour dire vrai, le pčlerinage est la grande affaire de notre génération, celle de ma propre vie en tous cas. C'est la grande affaire des laïcs qui s'y sont investis comme des fous - allez compter le labeur et les nuits que nous y avons consacré -. C'est aussi l'affaire des prętres car il s'agit de Chrétienté, ni plus ni moins qu'un projet de société selon le Cur de Dieu. Ce n'est pas rien !
Il convient donc que nos cadres et les pčlerins disposés auxquels est proposée cette donation officielle de leur propre personne - nous les avons précédés - acquičrent cette lucidité sur le sens et la vocation du pčlerinage et sur leur propre vocation. Il y faut le travail conjoint de la Foi et de la Raison, comme la indiqué Benoît XVI ā Ratisbonne. L'enjeu est de taille. La consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie devient alors une logique, un prolongement, une convenance gratuite et nécessaire. Mgr Perrier, en nous recevant la premičre fois dans sa cathédrale, nous recommandait d'ętre comme nos saintes patronnes, la Vierge Marie et sainte Jeanne d'Arc, humbles et intrépides. Voila un peu la feuille de route.
Je vous confie, chers frčres du pčlerinage, toutes ces réflexions. Ce sont celles d'un laïc - pas d'un prętre -, un militant buriné par 25 ans de bataille et de grand vent sur la route de Chartres. Souvent seul dans le désert et la rudesse de la vie chrétienne mais conduit par une main de Souveraine, une amie intime et lointaine, une vraie personne avec sa sensibilité, son port de tęte, son intelligence et sa volonté, son immédiateté, son intensité et l'incandescence de sa personnalité.
C'est la Mčre de Dieu - vertige !! -
Pierre Vaquié
Premier président
de Notre-Dame de Chrétienté
Consécration mariale, méditons encore
Témoignage dun consacré,
ancien président de Notre-Dame de Chrétienté
(actuellement secrétaire du comité de parrainage)
Le mouvement dappel ā la consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie prend de lampleur. Cest bien. Cest męme trčs bien car il répond ā une nécessité dordre stratégique pour le développement du pčlerinage et lédification de la chrétienté.
Ces considérations mont conduit ā ętre associé ā un travail de réflexion autour du développement de cette dévotion pour le bien de chacun et celui du pčlerinage.
Il s'agissait, en effet, darticuler la démarche individuelle de la consécration avec sa dimension communautaire et den solenniser la cérémonie.
On ma ainsi demandé dapporter mon témoignage et je le fais volontiers ici car, pour l'avoir vécu moi-męme, la consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie, en engageant tout l'ętre, est un acte autant individuel que communautaire.
C'est au cours d'une retraite ā Paray-le-Monial que, dans le secret de ma cellule, j'ai prononcé cette pričre avec la pleine conscience de faire un acte important bien que sans témoin. Pour aller jusqu'au bout de mon adhésion, j'ai męme signé le texte de cet acte de consécration, petit formulaire distribué habituellement par le Pčre Roustand aux retraitants. Jen ai gardé la trace. C'était le 22 août 1969.
Plus tard, c'était le 14 avril 1993, un mercredi soir, aprčs la messe mensuelle de préparation du pčlerinage, j'ai renouvelé ma consécration, seul au pied de l'autel, en présence de M. l'abbé Pozzetto, devant toute l'assemblée des fidčles. A l'issue de la lecture du texte, je suis allé déposer une rose sur l'autel. Nous en avions beaucoup parlé avec M. l'abbé; il nous paraissait nécessaire d'entourer cet acte d'une certaine solennité.
Avec le recul, on constate que cette appartenance, cet Ŧ esclavage ŧ, se traduit de faįon mystérieuse mais bien concrčte sur le cours de sa vie personnelle, famille, professionnelle (un certain 22 août 1989 pour moi par exemple) et "militante". Le ciel prend au sérieux nos engagements.
Par la suite, je me suis retrouvé aux postes de responsabilités que vous savez. Ce n'est pas au hasard que je donnais le signal du départ au pčlerinage ; je vérifiais, voir jattendais, quitte ā prendre du retard, que la statue de la Sainte Vierge ait rejoint la tęte de la colonne avant de donner le feu vert. Il y avait de ma part tout un acte d'allégeance et de supplication : " A vous de jouer, Notre Reine".
C'était ma maničre de répondre, en termes de stratégie, aux observations que je faisais de ce phénomčne Ŧ pčlerinage ŧ et j'étais bien placé pour l'ausculter. Quelle "main cachée" dirige ce pčlerinage ? A quelle vocation répond-il ? Quels en sont les enjeux alors que j'entends comme un air d'avant le ralliement de Léon XIII et męme d'avant 1793 ? Que se passe-t-il ? On croit ręver ; c'est inédit et totalement improbable. De plus, c'est beau et cela a une allure folle. C'est ma famille. Enfin !
On retrouve dans cet itinéraire personnel l'ensemble des questions que nous avons ā résoudre aujourd'hui : l'appel intérieur, les hésitations et les obscurités, la présence du prętre, la cérémonie et le signe sensible (un texte, une signature, une rose, un cierge, un pas, une procession, etc.), l'acte individuel et sa composante publique en raison de son inscription dans la logique du pčlerinage. Ce dernier paramčtre n'est pas secondaire ; il conditionne l'équilibre général de l'action collective que nous allons engager. A ce titre, nous pouvons garder en mémoire ces deux consécrations collectives, lune il y a deux ans avec cinq des principaux dirigeants de Notre-Dame de Chrétienté (H. de Gestas, B. de Beaurepaire, O. de Durat, M. Joulie et moi-męme), lautre le 29 septembre dernier avec la nouvelle équipe le noyau du chapitre Saint Joseph - autour dOlivier de Durat. Ce fut loccasion de lire des actes de consécration ā la fois individuels et collectifs.
Nous avons dit "stratégique". Le pčlerinage n'est pas une option ad libitum. C'est une "ardente obligation".
Certes, la Providence, dans sa gratuité, peut se passer de ce phénomčne marginal. Quest-ce quun petit pčlerinage ? Mais nous, responsables du pčlerinage, nous navons pas le droit de Ŧ planter le pélé ŧ. Et si vous saviez comme ce serait facile !
Pour dire vrai, le pčlerinage est la grande affaire de notre génération, celle de ma propre vie en tous cas. C'est la grande affaire des laïcs qui s'y sont investis comme des fous - allez compter le labeur et les nuits que nous y avons consacré -. C'est aussi l'affaire des prętres car il s'agit de Chrétienté, ni plus ni moins qu'un projet de société selon le Cur de Dieu. Ce n'est pas rien !
Il convient donc que nos cadres et les pčlerins disposés auxquels est proposée cette donation officielle de leur propre personne - nous les avons précédés - acquičrent cette lucidité sur le sens et la vocation du pčlerinage et sur leur propre vocation. Il y faut le travail conjoint de la Foi et de la Raison, comme la indiqué Benoît XVI ā Ratisbonne. L'enjeu est de taille. La consécration ā la Trčs Sainte Vierge Marie devient alors une logique, un prolongement, une convenance gratuite et nécessaire. Mgr Perrier, en nous recevant la premičre fois dans sa cathédrale, nous recommandait d'ętre comme nos saintes patronnes, la Vierge Marie et sainte Jeanne d'Arc, humbles et intrépides. Voila un peu la feuille de route.
Je vous confie, chers frčres du pčlerinage, toutes ces réflexions. Ce sont celles d'un laïc - pas d'un prętre -, un militant buriné par 25 ans de bataille et de grand vent sur la route de Chartres. Souvent seul dans le désert et la rudesse de la vie chrétienne mais conduit par une main de Souveraine, une amie intime et lointaine, une vraie personne avec sa sensibilité, son port de tęte, son intelligence et sa volonté, son immédiateté, son intensité et l'incandescence de sa personnalité.
C'est la Mčre de Dieu - vertige !! -
Pierre Vaquié
Premier président
de Notre-Dame de Chrétienté